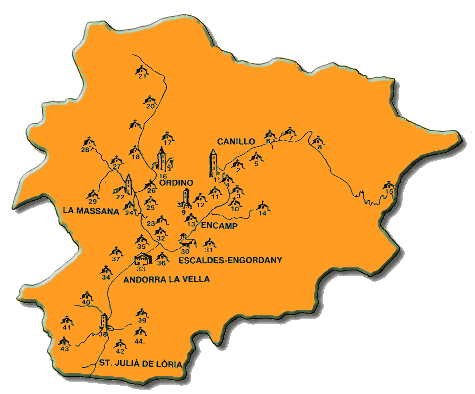L’Andorre
et ses monuments romans
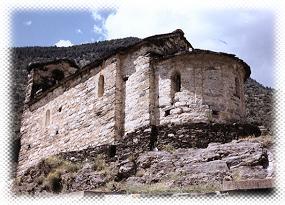 La
légende prétend que l’Andorre
a été fondée par Charlemagne
en l’an 805, mais si l’on en croit
les découvertes archéologiques
réalisées dans les années
1980, les traces des premiers habitants des
vallées remontent à 9000 ans avant
J.-C.
La
légende prétend que l’Andorre
a été fondée par Charlemagne
en l’an 805, mais si l’on en croit
les découvertes archéologiques
réalisées dans les années
1980, les traces des premiers habitants des
vallées remontent à 9000 ans avant
J.-C.
Les hommes se sont vite adaptés aux rudesses
du climat et du relief, utilisant peu à
peu les matériaux modestes et robustes
qu’offrent la montagne, la pierre, le
fer ou le bois pour édifier leurs premiers
abris.
Ainsi, au XIIe siècle, les églises
romanes, souvent frustres et sévères
semblent avoir fleuri aux points stratégiques
du paysage, parfois sur des constructions antérieures,
wisigothiques ou carolingiennes. A l’image
des « parrochiae » romaines, ces
centres de vie spirituelle et communautaires
jouent un rôle important dans les cérémonies
et les actes qui rassemblent les habitants des
paroisses. Surplombant la vallée, dressés
sur un contrefort rocheux, les clochers servent
de tour de guet pour avertir des dangers et
les porches ou les sanctuaires, espaces dévolus
au recueillement vont abriter les premières
formes de l’organisation politique andorrane.
La tradition préromane au IXe siècle
se caractérise par une abside carrée
séparée de la nef par un arc triomphal
outrepassé, un appareillage irrégulier,
des fenêtres archaïques à
ébrasement simple, ces édifices
sont réalisés avec les matériaux
disponibles sur place (granit, schiste, pierre
ponce, ardoise).
L’influence lombarde, venue d’Italie
du Nord se développe dans les vallées
à partir du XIIe siècle, ne modifiant
cependant en rien la modestie des édifices
habillés de galets ou de moellons dégrossis,
recouverts de crépis avec pour seul élément
décoratif des frises en pierre ponce
ou en dents de scie sur les porches des églises
et quelques visages stylisés sur les
clochers comme à Sant Miquel ou Santa
Coloma.

Tranchant
avec cette sobriété architecturale,
les clochers se dressent avec orgueil comme
celui d’Encamp qui culmine à 23
mètres. Véritables emblèmes
communautaires, ces tours rondes ou carrées
ont un rôle à la fois de défense
et de communication à l’instar
des forteresses cathares : du haut de ces promontoires,
on sonne le tocsin et l’on envoie des
signaux lumineux d’un bout à l’autre
de la Principauté.
Des restes de pigments noirs, rouges ou blancs
témoignent comme à Santa Coloma
de l’ancienne décoration polychrome
de ces tours. Les façades de pierre naturelle
étaient crépies et blanchies à
la chaux puis ornées de motifs géométriques
rehaussant l’architecture du bâtiment.
A l’intérieur de ces églises
l’on peut encore découvrir des
fresques d’une grande expressivité
narrative. Ces peintures dont le registre de
couleurs alterne du rouge au noir en passant
par le jaune ou le gris, occupaient autrefois
le chevet des édifices.
Outre les figures du collège apostolique,
les symboles des quatre évangélistes,
notons dans l’abside de
Sant
Marti de la Cortinada une composition assez
remarquable pour être détaillée:
D’un côté la représentation
de religieux de face parmi lesquels Saint Martin
de Tours et saint Brice, son successeur à
l’évêché tourangeaux;
De l’autre, des laïcs de trois quarts
parmi lesquels un joueur de viole, un danseur,
un archer et, se mêlant à l’ensemble,
des oiseaux et des animaux fantastiques.

Au
milieu du XIIe siècle un artiste désigné
sous le nom de maître de Santa Coloma,
influencé par la production du grand
Maître de Pedret, celle de Taüll
ou de la Seu d’Urgell, exerce ses talents
à Santa Coloma,
Sant
Miquel d’Engolasters, Sant Romà
de les Bons ou Sant Cristofol d’Anyos.
Ses représentations proches de la sensibilité
populaire se caractérisent par l’allongement
des visages ou l’accentuation des joues
et du front en utilisant des pigments rouges.
Si l’art roman ne pénètre
dans ces contrées de haute montagne qu’un
siècle après son apparition en
Catalogne, il s’y installe de manière
durable.
Certes, un retable baroque se substitue à
un décor roman mais dès qu’il
s’agit de construire un nouveau bâtiment
c’est sur le modèle médiéval
traditionnel.
Certains n’ont d’ailleurs pas hésité
à parler pour l’art roman, d’art
national andorran. Si bien que lorsque l’on
a reconstruit, en 1972,
le
sanctuaire de Meritxell endommagé
par un terrible incendie, l’architecte
Ricardo Bofill, fidèle au modèle
roman, l’a doté d’arcs pleins
cintres et a combiné ardoise et pierre
du pays dans sa réalisation. Exceptionnellement
bien conservées, les églises romanes
andorranes forment un ensemble unique et cohérent
que l’on peut visiter durant la période
estivale avec un service gratuit de guides culturels.
Les chemins de l’art roman, de Sant Miquel
à
Sant
Joan de Caselles, à découvrir
lors de votre prochaine visite en Andorre.